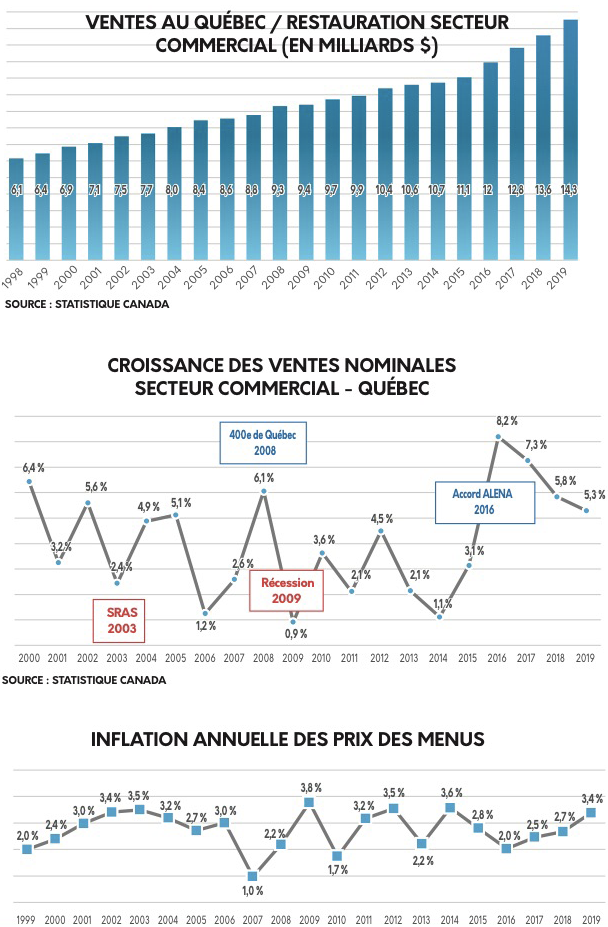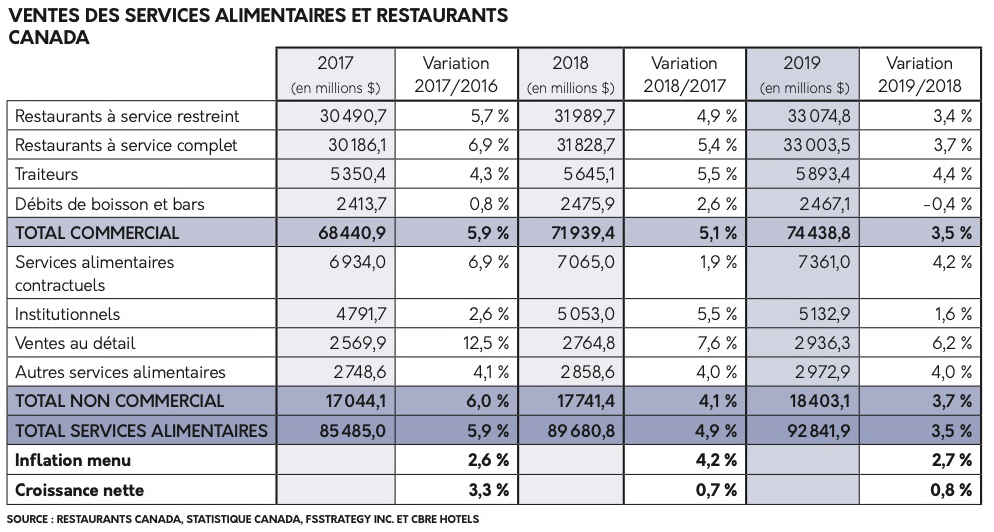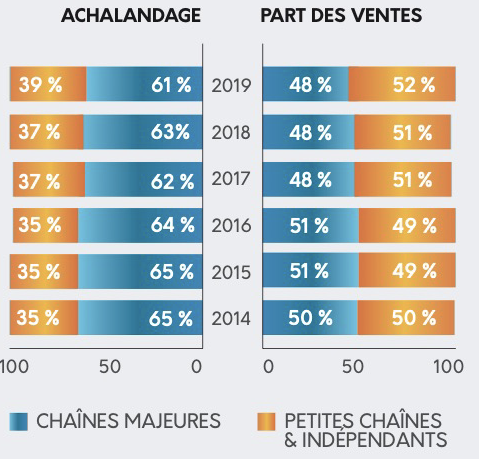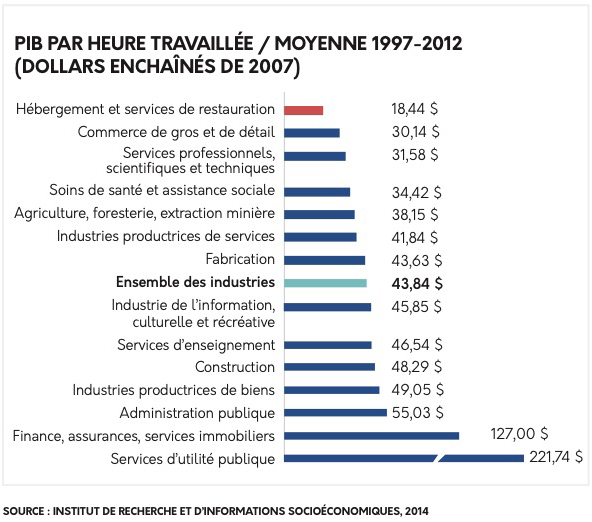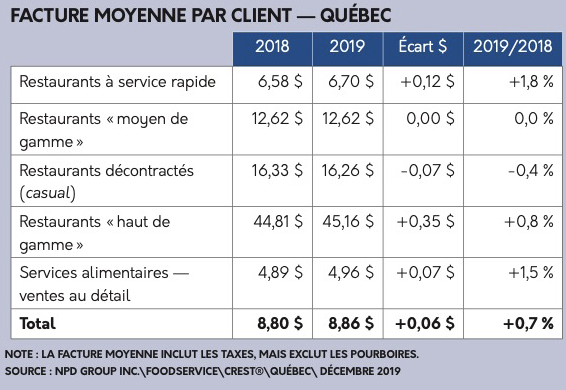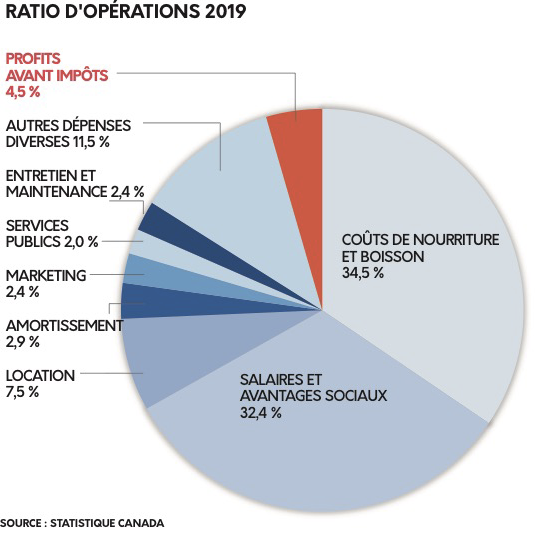Au sol, un plancher en époxy. Brillant. Impeccable. Face au visiteur, un comptoir au teint sombre, massif mais amovible. D’une éclatante propreté, lui aussi. Et dans tout l’espace, une incroyable lumière naturelle. Puissante et apaisante. Bienvenue dans le hall d’entrée du Griffintown Hotel, un établissement inauguré en juin dernier et posé au cœur du secteur éponyme de la métropole québécoise.
Si les travaux précédant l’ouverture du nouveau venu se sont étirés sur plusieurs mois, les responsables confient avoir réfléchi « le plus tard possible » à l’aménagement de la réception de l’hôtel. « On souhaitait tenir compte au maximum de l’avancée de la pandémie et des impacts qu’elle pouvait avoir sur les attentes de la clientèle, sur ses craintes éventuelles, souligne Laura-Michèle Grenier-Martin, directrice générale de l’hôtel. Il fallait que ce lobby puisse nous permettre d’accueillir, évidemment, mais aussi de rassurer. » En d’autres mots, faire rimer « convivialité » et « sécurité ».
Premier véritable point de contact physique entre le personnel de l’hôtel et ses visiteurs (sauf si l’établissement dispose d’un service de voiturier), le hall est un incontournable, un lieu de passage obligé. « Et puisque tous les clients y accèdent, l’hôtelier doit prendre le temps de bien le concevoir, il doit tout faire pour créer un "wow" immédiat », explique Marine Trehudic, enseignante en techniques de gestion hôtelière à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). « C’est là que commence l’expérience du visiteur », rappelle Joseph Klein, directeur général du Montréal Marriott Château Champlain [2].
Soif de vie
Au fil des décennies, au gré des modes, le hall a vu son utilisation évoluer et son design être adapté en conséquence. D’entrée baroque, festive et colorée, il était devenu, aux yeux de plus d’un voyageur, une simple étape technique, un lieu de transit uniquement associé à l’enregistrement. « Et malheureusement, nombre de professionnels le voyaient dès lors comme un espace peu ou pas rentable, comme un mal nécessaire », regrette Martin Leblanc, architecte, cofondateur et associé principal chez Sid Lee Architecture.
Mais l’heure de la revanche a sonné. Influencés par les nouvelles générations de voyageurs, conscients de l’incroyable potentiel des réseaux sociaux, propriétaires et gestionnaires d’hôtels ont recommencé à donner de l’amour à ces lieux, à leur consacrer temps et argent. « C’est redevenu un lieu de rencontres et de services, analyse Louise Dupont, designer et associée principale chez LEMAYMICHAUD. Mais en 2020, le lobby doit aussi - et avant tout - être conçu comme un espace de vie. » Les familles s’y attardent, armées de leur guide touristique, pour préparer la visite du quartier. Les gens d’affaires y passent deux ou trois heures, en attendant la prochaine réunion, le prochain rendez-vous, le prochain avion. Les millénariaux s’y posent pour déguster un café, sourire aux lèvres, téléphone à la main. « Le public s’est enfin réapproprié cet espace », résume Joseph Klein.
Si, à court terme, la COVID-19 et les règles d’hygiène et de distanciation sociale qu’elle a imposées freineront certainement ce nouvel élan, il y a fort à parier que les halls retrouveront rapidement leur esprit rassembleur et convivial. Ils pourraient également se voir attribuer de nouvelles fonctions et devenir les porte-parole des villes et des quartiers qui les accueillent. « Le lobby d’un hôtel, qu’il soit situé en région ou en milieu urbain, peut devenir une vitrine incroyable pour les artisans locaux qui pourraient y présenter et y vendre leurs produits », avance Martin Leblanc. Qu’ils soient fleuriste, boulanger ou torréfacteur, ces commerçants apporteront couleurs et odeurs à cet espace. Et ils procureront au passage des revenus non négligeables au propriétaire de la bâtisse.
Maxi-espace, micro-espaces
Les halls d’hôtel offrent généralement des volumes ô combien intéressants s’ils sont utilisés intelligemment. Lors des rénovations actuellement en cours, la direction du Château Champlain a ainsi décidé d’abattre quelques murs pour bénéficier d’un hall encore plus imposant. « Résultat : on dispose aujourd’hui d’un nouvel espace entièrement ouvert, avec un incroyable potentiel », décrit Joseph Klein. Cette unique salle sera par la suite divisée en plusieurs zones, sans mur ni barrière, mais à grand renfort de plantes et de canapés et en jouant sur les ambiances et la luminosité. « On veut créer des emplacements confortables et intimes, délimités mais ouverts », précise Jennifer Labrosse, directrice, ventes et marketing, du célèbre établissement montréalais.
Cette division et cette utilisation multiple des lieux peuvent également être appliquées dans les réceptions aux dimensions plus modestes, affirment les différents créateurs et concepteurs interrogés. « L’une des solutions est de rendre un peu floue la limite entre le lobby, le bar et le salon, d’entremêler les zones pour créer un bel espace multifonctionnel », illustre Martin Leblanc.
Comme plusieurs clients semblent encore hésiter à fréquenter les hôtels, l’organisation du hall doit, enfin, permettre de maximiser la fluidité et de simplifier les déplacements des utilisateurs et des membres du personnel. L’utilisation de portes différentes pour l’entrée et la sortie pourrait notamment créer un mouvement naturel, logique et « sécuritaire ».
Calendrier à repenser, budget à planifier
Aussi bruyantes puissent-elles être, les rénovations de quelques chambres, d’un couloir ou de salles de réunion n’empêchent généralement pas d’accueillir des clients dans les autres aires d’un établissement hôtelier. Mais lorsqu’il s’agit de transformer le hall principal, plus d’un dirigeant se demandera s’il doit fermer temporairement ses portes. « C’est un désagrément majeur, concède Martin Leblanc, mais le fait que, ces temps-ci, l’hôtel soit peu, voire pas du tout occupé peut être vu comme une bonne occasion d’accélérer ou de devancer des travaux. » Modifier le hall implique certaines dépenses, évidemment, mais il est possible, dans ces lieux, d’obtenir des résultats visuellement impressionnants sans se ruiner. « Avec un budget restreint, on peut faire des miracles », assure le cofondateur de Sid Lee Architecture. « Ça ne coûte pas plus cher de choisir la bonne couleur de peinture, ironise Louise Dupont (LEMAYMICHAUD). La clé, c’est de se donner dès le départ un objectif très clair et d’établir à l’avance un budget bien précis. On peut aussi effectuer les travaux par portions ou zones, sans rendre l’endroit inaccessible. Ça envoie, en outre, le message que l’hôtel s’adapte, que ses responsables sont proactifs. »
Place nette
Laura-Michèle Grenier-Martin le répète à l’envi et avec une fierté non dissimulée : elle est persuadée d’avoir mis la main sur « les plus beaux "plexi" du marché ». « Ce n’est pas parce qu’il y a une pandémie qu’on ne peut pas faire quelque chose d’esthétique ! » lance la dynamique directrice générale.
Mais bien plus que les détails du mobilier ou les matériaux utilisés, c’est le recours à la lumière naturelle qui permettra de séduire les visiteurs. « Désormais, l’extérieur est vu comme un endroit sûr et sain, note Marjorie Bradley, architecte chez Sid Lee Architecture. Il faut donc maximiser la luminosité naturelle, la faire entrer, et tout faire pour mettre en valeur le dehors, la rue ou le paysage qui entoure l’hôtel. » « De plus, repenser l’éclairage est sans doute l’aménagement qui aura le plus d’impact au moindre coût », ajoute son confrère. En installant dans le hall des escaliers « intéressants et aérés », l’hôtelier pourrait par exemple amener un puits de lumière aussi esthétique qu’utile.
Les opérateurs préféreront par ailleurs les éléments facilement déplaçables, ce qui permettra d’aisément modifier l’apparence des lieux et de pouvoir s’adapter à d’éventuelles nouvelles règles d’hygiène et de sécurité. « Ici, tout est modulable et interchangeable, témoigne la dirigeante du Griffintown Hotel. On a aussi opté pour un certain minimalisme : qui dit "moins d’objets et de meubles" dit "moins de nettoyage". »
Du sol au plafond, des fauteuils à la sonnette posée sur le comptoir d’accueil, tout, dans le hall, doit respirer la propreté et inspirer confiance aux visiteurs. Oubliés, les innombrables coussins décoratifs et les couvertures de fourrure négligemment jetées sur les canapés. Bannies, les surfaces trop réfléchissantes qui enregistrent et trahissent la moindre trace de doigt. Finis, les quelques jouets destinés à faire patienter le jeune public ou les piles de livres évoquant les voyages. « Enlevez tout ce qui est inutile, traduit Louise Dupont. Mais usez également de votre gros bon sens et n’oubliez pas que le client veut se sentir dans un hôtel, pas dans un laboratoire ! »
La lumière s’invite dans l’entrée du Griffintown Hotel
(Crédit photo : Raphaël Tibodeau)
Longtemps, le nettoyage s’est fait discret et était effectué, dans la mesure du possible, à l’abri des regards du visiteur. Aujourd’hui, pandémie oblige, ce dernier veut être rassuré. Le client veut savoir si c’est propre ? Montrez-lui, parlez-lui, expliquez-lui.
Réinventer les incontournables
Distributeurs de savon ou de gel, panneaux incitant au port du masque ou offrant de l’information sur les mesures d’hygiène, flèches tracées sur le sol... : depuis quelques mois, plusieurs éléments se sont invités dans le décor des réceptions d’hôtels. Et nombre d’entre eux pourraient y être installés pour une longue durée. « Il ne faut pas les cacher, mais les mettre en évidence, qu’ils soient bien visibles, indique Martin Leblanc. Cela envoie le message que, chez vous, la sécurité est prise au sérieux ; ça témoigne d’une réelle prise de conscience des gestionnaires de l’établissement. »
Mais n’allez surtout pas croire qu’il n’y a rien qui ressemble plus à une flèche ou à un masque qu’une autre flèche ou un autre masque et que, s’ils veulent respecter les mesures d’hygiène, tous les hôtels de la province sont appelés à entrer dans le même moule : ce serait mal connaître le potentiel créatif des designers de ce monde. « Il y a évidemment moyen de se différencier et de se distinguer, de donner une réelle identité à ces éléments, assure Louise Dupont. Prenons l’exemple de la flèche : tant qu’on garde le signe graphique reconnu, tant qu’elle indique une direction, il est possible de jouer sur les courbes, les angles, la dimension et l’emplacement, d’intégrer le logo ou les couleurs de l’hôtel. Ça peut être ludique, ça peut être artistique. Tout est possible ! »
(Gracieuseté : Marriott Château Champlain)
En ces temps particuliers, l’entrée d’un établissement hôtelier doit remplir plusieurs rôles. Outre les habituels enregistrements, elle doit permettre aux équipes d’aller à la rencontre du visiteur, de l’informer et de le rassurer, de lui expliquer ce qui est mis en oeuvre pour assurer son confort et sa sécurité durant son séjour. Mais le lobby doit également accueillir chaleureusement ce visiteur, le faire voyager, l’aider à déconnecter dès qu’il aura franchi le seuil de l’hôtel. Il doit être à la fois esthétique et sécuritaire. « Cela demande de l’investissement et de la réflexion, mais c’est tout à fait compatible », affirme Marine Trehudic. « Il suffit, comme toujours, d’engager les bons professionnels... », conclut, sourire aux lèvres, Louise Dupont.
Technologie vs Humain
Au cours des dernières années, écrans, applications et autres outils modernes ont cherché à s’inviter dans les réceptions de nos hôtels. Mais ces technologies ont encore une certaine difficulté à s’imposer, selon Marine Trehudic (ITHQ). Un avis que partagent les autres experts interrogés. « La technologie doit simplifier l’expérience client - pas compliquer les choses », fait remarquer Martin Leblanc, qui évoque « un retour à l’humain » dans nos établissements. « Et puis, ça coûte encore assez cher », ajoute Laura- Michèle Grenier-Martin (Griffintown Hotel). « Dans un lobby, la technologie doit être là, mais invisible. On ne doit surtout pas l’imposer aux visiteurs », résume Joseph Klein (Montréal Marriott Château Champlain).
(1) Joseph Klein a cédé les rênes du Montréal Marriott Château Champlain à Yvan François Bailbled le 19 août dernier, quelques jours après nous avoir accordé cette entrevue.